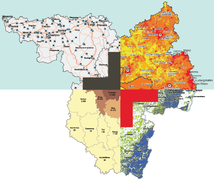Grande Région
Gouvernance
La Présidence de la Grande Région
La présidence de la Grande Région est exercée à tour de rôle par chaque partie constituante pendant 18 mois.
Plus d'infos
Organes à l’échelle régionale
Le Conseil Parlementaire Interrégional – CPI (1986)
Créé en 1986, le CPI est l'assemblée consultative de la Grande Région composée d’élus de la Région Grand Est, de la Chambre des députés du Grand-duché de Luxembourg, du Land de Rhénanie-Palatinat, du Land de Sarre et du Parlement wallon, des parlements de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Communauté germanophone de Belgique. Le CPI vise à :
- Promouvoir le rôle économique, social et culturel de la Grande Région par une étroite collaboration transfrontalière.
- Contribuer au développement d’une perspective de coopération transfrontalière dans les domaines relevant de la compétence normative de chaque région. Plus d'infos
Sommet des exécutifs de la Grande Région (1995)
Ce sommet, créé en 1995, rassemble les chefs des exécutifs des Etats ou des Régions faisant partie du territoire de la Grande Région. Il se consacre à un thème en particulier et a pour objectif de donner des impulsions à la coopération transfrontalière et interrégionale. Il se réunit deux fois par an et fonctionne avec une présidence tournante. Il est notamment chargé de préparer la "Déclaration commune" adoptée lors du sommet.
en 2014, le Secrétariat permanent du Sommet s'est constitué en un Groupement européen de coopération territoriale (GECT). Basé au Luxembourg, il permet d’améliorer le suivi des projets et la gouvernance des travaux du Sommet et d'assurer la coordination avec le Comité économique et social et le Conseil Parlementaire Interrégional de la Grande Région. Plus d'infos
Le Comité économique et social de la Grande Région – CESGR (1997)
Il s'agit d'un organe consultatif à vocation socio-économique. Il a pour mission d’émettre des avis ou des résolutions concernant les enjeux inhérents au développement économique, social, culturel et à l’aménagement du territoire de la Grande Région. Ses travaux sont coordonnés avec ceux du Sommet pour éviter les doublons, et les communications entre les deux structures permettent de concevoir des projets structurants. Il contribue au dialogue social en se référant aux recommandations et expériences des partenaires. Plus d'infos
Région métropolitaine polycentrique transfrontalière - RMPT (2011)
La RMPT a pour finalité d’assurer à la Grande Région une visibilité et une compétitivité de niveau européen. Son objectif est de donner à cet espace une masse critique en s’appuyant sur les réseaux de villes de taille moyenne qui structurent le territoire. Plus d'infos
Autres organes à l’échelle locale
EUREGIO SarLorLux+ (1995)
Cette association sans but lucratif de droit luxembourgeois créée en 1995 a comme objectifs de promouvoir et de renforcer la coopération des communes de la Grande Région et de représenter et défendre leurs intérêts auprès des instances transfrontalières de la Grande Région. Plus d'infos
Pôle Européen de Développement de Longwy (PED) , 1996)
Le Pôle Européen de Développement de Longwy, situé au point frontière avec le Luxembourg et la Belgique, forme une agglomération transfrontalière rassemblant 22 communes sur les 3 pays. Longtemps spécialisé dans l’industrie minière et sidérurgique, il s’agit aujourd’hui d’un territoire en reconversion. Plus d'infos
QuattroPole (2000)
Le "Pôle de Communication Luxembourg, Metz, Sarrebruck, Trèves" (QuattroPole), créé en 2000, est un réseau de villes transfrontalier, dont l'objectif est de renforcer le développement économique de la Grande Région. Ses thèmes sont centrés sur la gestion urbaine, l'environnement, l’énergie, la promotion culturelle et touristique, l'amélioration des infrastructures de télécommunication et les nouveaux médias. Plus d'infos
Le Sillon lorrain
Organisé en réseau, le Sillon Lorrain comprend les villes et agglomérations de Metz, Nancy, Thionville, et Epinal, représentant 600 000 habitants. Son objectif est la promotion commune des enjeux liés au développement du territoire lorrain. Grâce à la création en 2012, du "Pôle métropolitain" du Sillon Lorrain (premier en France), le réseau se dote d’une architecture dynamique et opérationnelle afin de faire émerger des projets innovants dans les domaines économiques, universitaires, médicaux, culturels ou touristiques. Plus d'infos
Eurodistrict SaarMoselle (2010)
Constitué sous la forme d'un GECT en 2010, l'Eurodistrict SaarMoselle regroupe côté allemand la Communauté urbaine de Sarrebruck et, côté français, sept communautés d’agglomération et communautés de communes. Il a élaboré une "Vision d’Avenir" contenant les grandes lignes de son développement transfrontalier à long terme. Plus d'infos
Alzette-Belval (2012)
Le projet "Alzette-Belval", aire urbaine transfrontalière franco-luxembourgeoise, porte sur la reconversion d’une friche sidérurgique en pôle tertiaire. Projet urbanistique et d'aménagement très important, il s'est doté d'une gouvernance transfrontalière propre, sous la forme d’un GECT. Plus d'infos