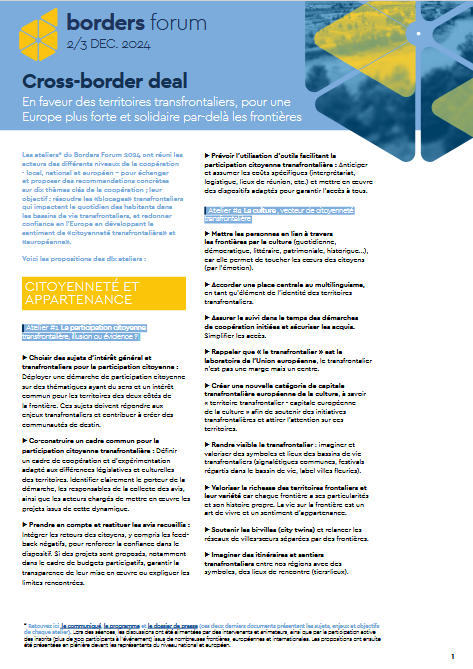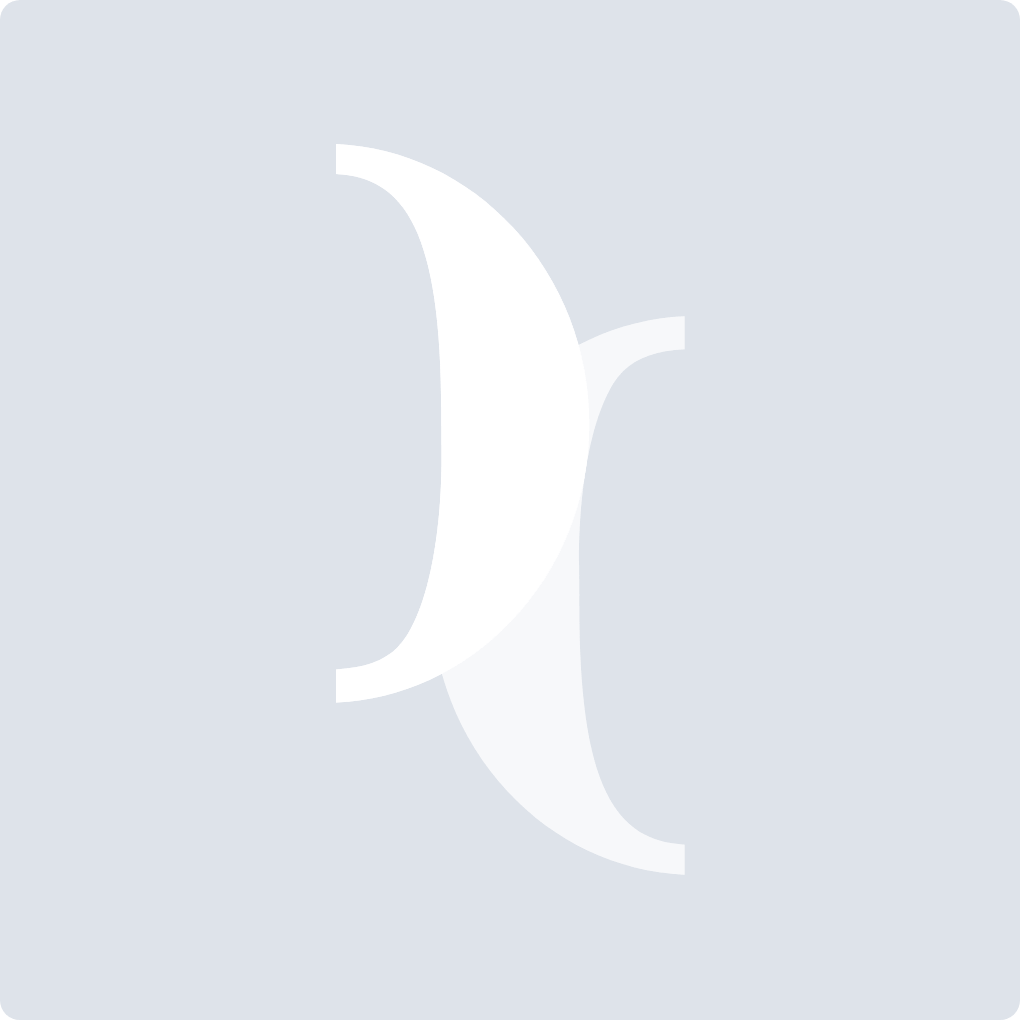Services publics
- Actualités
- Événements
- Publications MOT
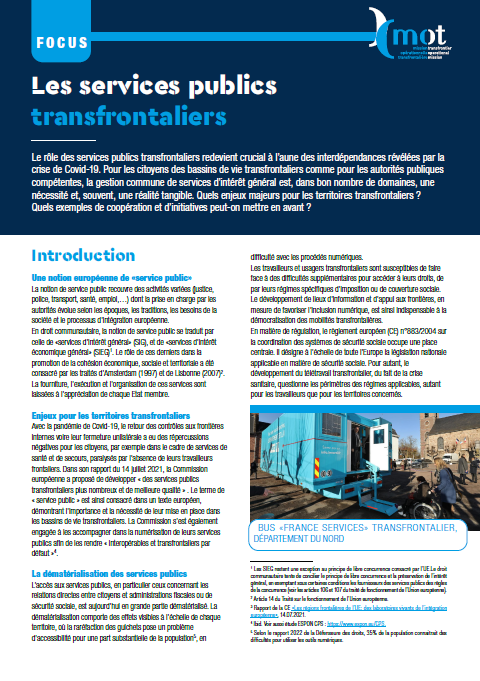
Les services publics transfrontaliers
Introduction
La notion de service public recouvre des champs d’intervention extrêmement variés, allant des activités dites régaliennes (justice, police, armée) à d’autres activités (transport, santé, emploi, culture…) dont la prise en charge par les autorités nationales, régionales et locales évolue en fonction des époques, des traditions culturelles, historiques, des besoins de la société, ainsi que du processus d’intégration européenne (libre circulation des services, marché unique, politique de concurrence, législation sur les Services d’intérêt général, …).
Au niveau communautaire, il n’existe pas de normalisation des services s’imposant à l’ensemble des Etats membres. Seuls les grands services de réseaux (électricité, gaz, transports, poste, télécommunication,..) ont fait l’objet de réglementations sectorielles suite à leur libéralisation totale ou partielle. La notion de service public n’existe d’ailleurs pas en tant que telle en droit communautaire, la législation et la jurisprudence européenne utilisent les notions de « services d’intérêt général » (SIG), ou de « services d’intérêt économique général » (SIEG).
Les SIEG restent une exception au principe de libre concurrence consacré par l’Union européenne. Le droit communautaire tente de concilier le principe de libre concurrence et la préservation de l’intérêt général, en exemptant sous certaines conditions les fournisseurs des services publics des règles de la concurrence (voir les articles 106 et 107 du traité de fonctionnement de l’Union européenne).
Le rôle des SIG dans la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale a été consacré par les traités d’Amsterdam et de Lisbonne (article 14 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne)1, qui stipulent que les SIG font partie des « valeurs communes » de l’Union européenne.
Une marge d’appréciation est laissée aux autorités publiques sur la base de leurs compétences, dans leur choix de fournir, faire exécuter et organiser des services. Dans le contexte transfrontalier, l’ouverture des frontières, tant en termes de marchés que de coopération des autorités publiques, offre des opportunités nouvelles de mutualisation des services publics ; la diversité des régimes applicables et des politiques en la matière complexifie toutefois cette ouverture. Pour le citoyen habitant en territoire transfrontalier comme pour les autorités publiques compétentes, la gestion commune de services d’intérêt général est devenue, dans bon nombre de domaines, une nécessité et, souvent, une réalité tangible.
L’ouverture du marché intérieur a engendré une intensification des flux transfrontaliers. Les services publics doivent donc s’adapter aux nouveaux besoins des habitants qui travaillent, étudient, se soignent… de part et d’autres des frontières. La fourniture des services nécessaires à ces populations, ne peut par conséquent s’arrêter aux abords des frontières nationales.
Avec la pandémie de Covid-19, la fermeture unilatérale des frontières par les Etats a eu des répercussions négatives pour les citoyens vivant dans les régions frontalières avec des mesures paralysant les services de santé et de secours, en l’absence de leurs travailleurs frontaliers. Cette crise a permis de révéler au grand jour les interdépendances et le rôle crucial des bassins de vie transfrontaliers, rendant d’autant plus nécessaire l’élaboration d’approches européennes coordonnées (voir document clé) face aux problèmes communs rencontrés. C’est dans ce contexte que la Commission européenne a décidé de recentrer ses actions en faveur des régions frontalières dans son rapport du 14 juillet 2021, avec notamment un deuxième pôle pour développer « des services publics transfrontaliers plus nombreux et de meilleure qualité » (voir document clé). Ce rapport évoque également la question du changement climatique avec la mise en place du Pacte Vert pour la décennie 2020-2030. Ce dernier constitue une opportunité de renforcement de services publics transfrontaliers, nécessaires pour une prise en charge mutualisée aux frontières des enjeux de transition écologique et d’adaptation au changement climatique, tels que la régulation de la qualité de l’air, la préservation de la biodiversité, la gestion intégrée des ressources ou encore la prise en charge des crises et des risques climatiques.
Enfin, dans le cadre de la politique de cohésion 2021-2027, l’objectif stratégique 1 vise à la « transformation vers une économie intelligente et innovante » incluant en particulier la numérisation des services publics. L’e-éducation et l’e-administration (par exemple le développement de l’open data) permettent un meilleur accès des populations aux ressources éducatives (accès aux bibliothèques numériques par exemple) et aux services publics et administratifs des deux côtés de la frontière, dans un souci d’une meilleure intégration du territoire transfrontalier. D’autres domaines comme la culture (développement de media transfrontaliers, etc.) ou la sécurité sont pertinents dans le contexte transfrontalier.
La continuité d’un territoire et la reconnaissance d’une communauté transfrontalière, dépendent de la possibilité de communiquer sans restriction, de l’existence de moyens de transport permettant la mobilité de part et d’autre des frontières, de la valorisation du patrimoine commun, d’une politique de l’emploi participant au développement économique. Une action publique coordonnée, capable de prendre en charge des activités essentielles à la population, est nécessaire surtout lorsque l’action du marché seul, par le jeu de la libre concurrence, s’avère insuffisante.
Les services d’intérêt général transfrontaliers jouent donc un rôle essentiel en matière de cohésion sociale et territoriale, de croissance et d’emploi.
La participation des services publics à la cohésion des territoires transfrontaliers
L’accès de tous les citoyens et entreprises à des services d’intérêt général de qualité et abordables est essentiel pour lutter contre l’exclusion sociale et pour favoriser la cohésion sociale et territoriale des territoires transfrontaliers.
L’étude menée par ESPON en 2019 montre la progression du développement des services publics à l’échelle européenne sur les dernières années. Selon cette étude, les services publics transfrontaliers traitent majoritairement de la protection de l’environnement, de la protection civile et de la gestion de la catastrophe ou des transports. 60% des services publics référencés relèvent de ces domaines de politiques publiques.
La coopération dans des domaines des soins de santé, l’aide à l’enfance ou la prise en charge des personnes âgées, l’aide aux personnes handicapées ou l’organisation de soins hospitaliers transfrontaliers, contribuent à la promotion de la cohésion sociale du territoire (voir les thèmes « Santé » et « Inclusion sociale »).
La coopération dans les secteurs de l’éducation, de la formation et des services à l’emploi (voir les thèmes « Emploi » et « Education, formation, langues ») joue un rôle clé en matière de croissance et d’emploi. L’organisation de réseaux transfrontaliers en matière de transport (voir le thème « Transport ») est également essentielle pour développer la mobilité des travailleurs tout en permettant de promouvoir une politique écologique par le désengorgement des routes.
L’agenda territorial 2030, fournit un cadre intergouvernemental réunissant les ministres chargés de l’aménagement du territoire, du développement territorial et/ou de la cohésion territoriale des Etats membres de l’UE. Il vient compléter le cadre législatif européen avec des actions concrètes pour encourager la cohésion territoriale en Europe. Il s’agit de l’un des objectifs de l’Union européenne tel que définis dans l’article 3 du traité sur l’Union européenne. La cohésion territoriale permet d’améliorer l’égalité des chances et cela passe notamment par la possibilité pour les citoyens et les entreprises d’avoir accès à des services publics de qualité, indépendamment de l’endroit où ils se trouvent.
L’Europe compte de nombreux types de territoires qui présentent des potentiels et des problèmes de développement très variés. Cette diversité est notamment due à l’existence ou non d’économies d’échelle, à un accès inégal aux marchés et à l’emploi qualifié ou encore à des services publics de qualité différente.
L’Agenda territorial 2030 met ces défis en évidence et attire l’attention des décideurs politiques sur ces problématiques. Il convient d’agir dans les domaines suivants, et notamment en ce qui concerne l’offre de services publics :
- Qualité de vie : toutes les politiques publiques devraient avoir pour objectif sous-jacent d’améliorer le bien-être et la qualité de vie des citoyens et cela passe notamment par un accès à des services publics de qualité
- Services d’intérêt général : l’accessibilité, la proximité, l’abordabilité et la qualité des services publics sont déterminantes pour la qualité de vie et pour le développement des entreprises.
- Déséquilibres démographiques et sociaux : le vieillissement de la population, la dépopulation, les migrations internes et externes, , doivent être pris en compte par les systèmes de sécurité sociale européens ainsi que par les politiques de développement local et régional. Ces phénomènes qui ont d’importantes implications sociales constituent des défis pour la fourniture des services publics. Les zones reculées sont particulièrement touchées et souffrent d’un accès insuffisant aux services publics.
La coopération territoriale et maritime dans les différents pays et notamment au niveau transfrontalier permet de mieux utiliser les potentiels de développement des uns et des autres et de résoudre des problèmes communs. En unissant leurs forces de part et d’autre des frontières, et notamment dans le cadre des projets INTERREG, les territoires peuvent se développer et réduire la fragmentation économique, sociale et environnementale et les externalités négatives. Cela peut notamment concerner la fourniture de services publics. Dans le cadre de l’agenda territorial 2030, des mesures seront prises pour incorporer dans les stratégies de développement macro-régionales, nationales, régionales et locales une coopération transfrontière, transnationale et interrégionale pérenne.
Afin de renforcer une action publique de proximité, plusieurs territoires ont aussi mis en place des points d’information et d’accompagnement aux démarches administratives à destination des citoyens transfrontaliers. Des difficultés importantes d’accès aux droits se présentent pour les travailleurs frontaliers, concernant notamment les prestations sociales ou la fiscalité, et relèvent majoritairement du cas par cas en nécessitant un appui des acteurs publics. Ainsi, de nombreuses structures existent : la MOSA à Forbach, la Maison du Luxembourg à Thionville et autres « maisons » pour répondre aux enjeux connus par les habitants frontaliers, le réseau des INFOBEST, ou encore l’association Frontaliers Grand Est. En dehors des structures d’accueil, d’autres réseaux existent au sein même des opérateurs de prestations sociales ou de services publics de l’emploi : coordination des opérateurs de sécurité sociale assurée par le Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS), le réseau des EURES… Ces différents dispositifs d’information permettent notamment de renforcer la cohésion, le sentiment d’appartenance et l’accès à l’emploi dans les zones transfrontalières.
En France, le label France Services de l’ANCT est attribué à tous les lieux d’information et d’accompagnement vers l’accès aux services publics numérisés comprenant au moins 9 opérateurs nationaux partenaires (CAF, Assurance Maladie, Assurance Retraite, Pôle Emploi, La Poste, Ministère de l’Intérieur, Ministère de la Justice…). Ces espaces (qui peuvent prendre par ailleurs les contours de Centres Communaux d’Action Sociale CCAS, Point d’Information et de Médiation Multi Services PIMMS, Ex-Maisons de Services Au Public MSAP…) visent à permettre à chaque citoyen quel que soit l’endroit où il réside d’accéder aux services publics numérisés et d’être accueilli dans un lieu unique, par des personnes formées et disponibles, pour effectuer ses démarches du quotidien. Pour les territoires frontaliers et en réponse aux demandes des usagers, l’un des enjeux peut être de parvenir à l’ouverture transfrontalière de ces espaces, afin de prendre en compte les services équivalents au sein du pays voisin.
Mutualiser une offre transfrontalière de service public
De nombreux services à la population sont organisés par les autorités publiques, mais les dispositifs nationaux et régionaux d’organisation des services prennent souvent insuffisamment en compte la possibilité de bénéficier des services de l’autre côté de la frontière, voire de coordonner leur conception et leur mise en œuvre en transfrontalier.
La difficile lisibilité des différentes organisations administratives territoriales de part et d’autre des frontières engendre des difficultés pratiques de coopération.
Or le potentiel de coopération est important et les pays frontaliers sont fréquemment ouverts à une mutualisation de leurs services avec ceux des pays voisins.
La mutualisation des services aux habitants à l’échelle du bassin de vie transfrontalier permet d’aller vers une recherche du meilleur service, plus accessible, au meilleur prix. Par exemple, dans le domaine de l’environnement, la mutualisation du service de traitement des eaux peut avantager de façon complémentaire les partenaires d’une coopération. La création d’une station d’épuration transfrontalière à Puigcerdà a eu pour objectif, côté espagnol, d’assainir les eaux usées de deux grandes communes (Puigcerdà et Llivia) afin d’améliorer la qualité des eaux de rivière, et côté français, de trouver une solution économiquement intéressante à l’impératif d’assainissement des communes de Bourg Madame et du Syndicat d’eau potable.
Penser les services publics à l’échelle transfrontalière permet une meilleure couverture du territoire. Cependant la mise en œuvre de ces projets est souvent freinée par les différences de législation et de cultures administratives et juridiques, et nécessite à la fois une solide coopération engageant élus et acteurs de terrain, et un cadre juridique adéquat permettant de répondre aux questions de responsabilité et de financement des services.
En particulier, l’existence d’un cadre législatif européen de plus en plus structurant pour les législations nationales ne suffit pas à garantir leur interopérabilité aux frontières ; une coordination multi niveaux entre pays voisins s’avère nécessaire. Le développement, à la demande du Conseil européen, de stratégies macro-régionales dans les régions de la Baltique et du Danube, a été l’occasion d’une prise de conscience européenne à ce sujet. Le problème reste toutefois identifié depuis longtemps par les acteurs de la coopération transfrontalière, donnant lieu à des démarches pilotes, telles que le processus de coordination mis en œuvre par le Groupe de travail parlementaire franco-belge à partir des années 2000.
De plus, si la mise en œuvre de tels services doit faire face à de nombreux obstacles institutionnels, économiques, juridiques et supposant une importante capacité de coopération, la signature du traité franco-allemand d’Aix la Chapelle en Janvier 2019 doit permettre de substantielles avancées en la matière, avec la mise en place d’un comité de coopération transfrontalier ayant spécifiquement vocation à traiter les différents obstacles de mise en œuvre de services intégrés à l’échelle de la frontière.
Eléments de mise en œuvre d’une coopération transfrontalière en matière de service
L’identification des autorités compétentes
Comme dans toute coopération, la création d’un équipement commun ou la mutualisation d’un service, nécessitent au préalable de bien identifier les personnes publiques compétentes.
En pratique, il est important de vérifier dans le droit interne et dans les dispositions des statuts respectifs qui régissent les autorités partenaires, si elles disposent bien de la compétence pour coopérer dans un domaine précis.
Une compétence détenue par un EPCI côté français peut être détenue par une région de l’autre côté des frontières (par exemple dans le domaine de l’organisation des transports routiers de personnes). Il est important d’identifier la base légale et le mode d’exercice de cette compétence (compétence d’attribution, « clause de compétence générale », compétence exclusive ou partagée).
Une fois ces acteurs publics identifiés, il est également intéressant de comparer leurs modes d’intervention et de financement respectifs dans le champ d’action concerné (par exemple transport, assainissement, culture, développement économique….). Cette analyse (des compétences, des modes d’intervention et de financement des partenaires du projet) permet de préparer le choix d’un montage opérationnel transfrontalier compatible avec le cadre juridique et opérationnel existant de part et d’autre de la frontière.
L’utilisation des outils juridiques adéquats
Chaque projet transfrontalier s’inscrit dans un cadre juridique et opérationnel qui lui est propre, en fonction de la nature des partenaires concernés, de la thématique concernée (par exemple l’environnement, les transports, la culture…) et du type d’action envisagé (mise en réseau, investissements communs…).
Pour coopérer au travers des frontières, les collectivités locales et leurs groupements peuvent s’appuyer sur différentes bases juridiques nationales, européennes et internationales, qui définissent autant d’outils de coopération constituant ainsi une réelle « boîte à outils du transfrontalier ».
La recherche d’un cofinancement des services transfrontaliers
La question du financement des projets transfrontaliers est au cœur des préoccupations des partenaires des démarches transfrontalières. Le financement des actions de coopération transfrontalière repose en principe sur le budget des différentes collectivités et autorités locales qui engagent ces actions.
La principale difficulté réside toutefois dans le fait que la capacité juridique à engager une action transfrontalière ou à réaliser un investissement transfrontalier ne confère pas pour autant aux autorités locales la capacité financière de réaliser cette action ou cet investissement.
De nombreux projets d’investissement, de création de réseaux ou de services transfrontaliers, par leurs envergures interrégionales ou internationales et les investissements financiers qu’ils nécessitent, ne peuvent pas être pris en charge par les seules collectivités et autorités locales frontalières.
Il est par conséquent important pour ces collectivités, dans leurs démarches transfrontalières, de réfléchir en termes de « cofinancement » en organisant des « tours de table » c’est-à-dire en mobilisant, pour assurer le financement de projet, tous les échelons concernés. Le recours à des fonds européens est aussi envisageable pour aider aux financements des projets transfrontaliers.
Développer des schémas de services transfrontaliers
La situation des territoires riverains frontaliers dans les documents d’aménagement est trop souvent ignorée et ne permet pas de rechercher les solutions les plus pertinentes en matière de services. Développer un volet transfrontalier dans les schémas et programmes des Etats et des collectivités territoriales des zones frontières permettrait d’identifier les services existants dans les pays voisins et de déboucher sur la création de services transfrontaliers mutualisés.
Ces schémas de services peuvent être développés par exemple en matière :
- de transports publics : lignes de bus ou de TER transfrontalières avec tarification commune, démarches de type « Plan de Mobilité »
- de santé : dans les schémas régionaux d’organisation des soins (prise en compte de l’organisation des structures de santé et hospitalières du pays voisin, accès aux soins)
- d’environnement : dans les schémas d’eau et d’assainissement (prise en compte des possibilités d’alimentation en eau sur les ressources du pays voisin, et réciproquement ; et sur l’assainissement, possibilité d’utiliser conjointement les installations de traitement des eaux usées)
- d’accessibilité aux services publics : schémas départementaux notamment
- d’emploi : dans les schémas de services dans le domaine de l’emploi…