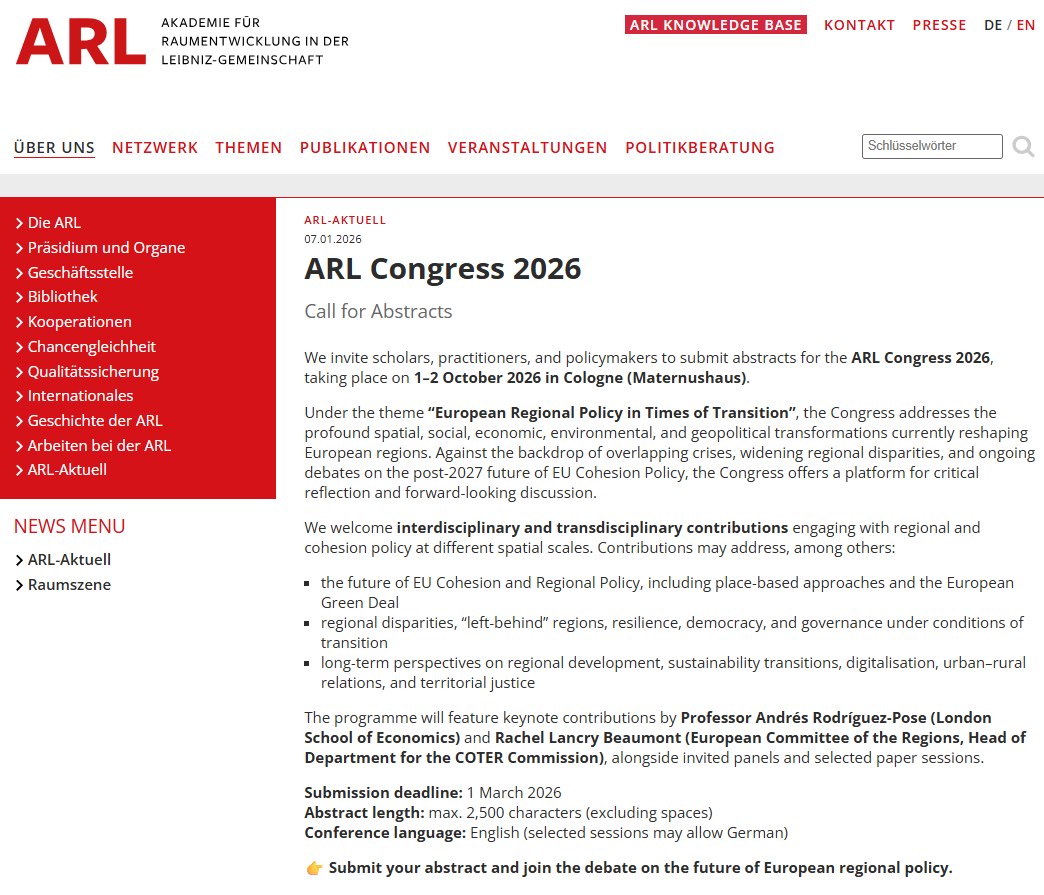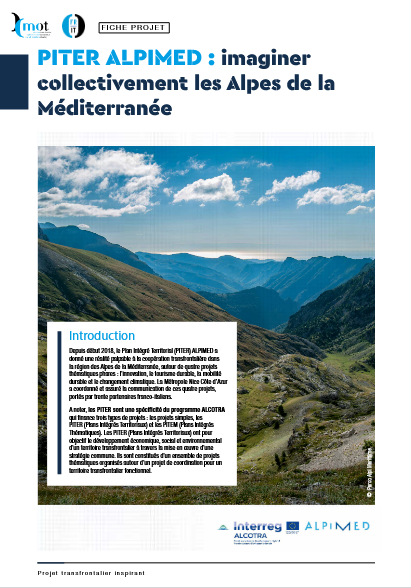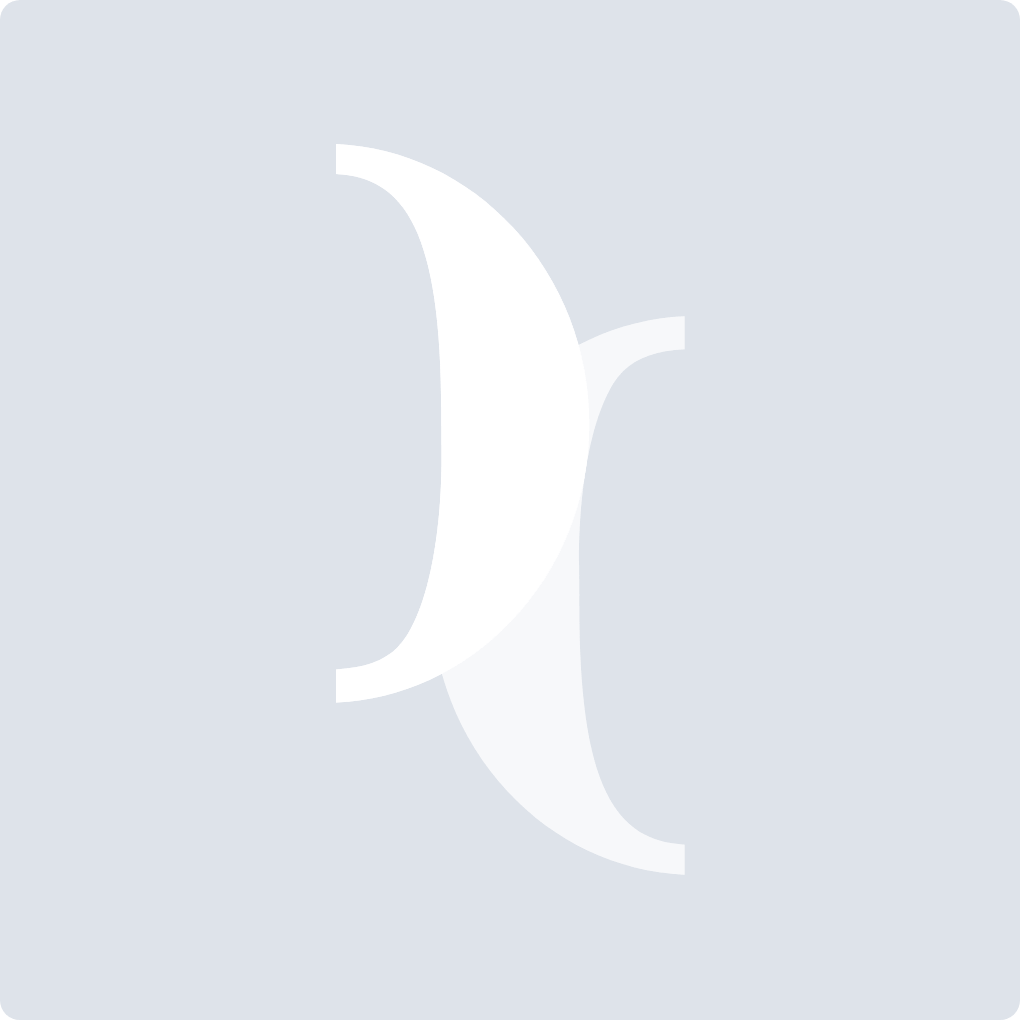Recherche et innovation
- Actualités
- Événements
- Publications MOT
Répondre à la stratégie « Horizon Europe »
Pour moderniser l’espace européen de la recherche, l’Union européenne a mis en place un programme-cadre pluriannuel pour la recherche et l’innovation : le programme Horizon Europe qui agit sur la période 2021-2027. Ce programme régit la coopération entre l’Union européenne et les pays tiers dans le domaine de la recherche et de l’innovation. Les objectifs généraux du programme « Horizon-Europe » sont :
- renforcer les bases scientifiques et technologiques de l’Union ;
- stimuler sa compétitivité, y compris celle de son industrie ;
- concrétiser les priorités politiques stratégiques de l’Union ;
- contribuer à répondre aux problématiques mondiales, dont les objectifs de développement durable.
Le programme s’organise autour de quatre piliers : la science d’excellence (27% du budget total), les problématiques mondiales et la compétitivité industrielle européenne (55,3% du budget total), une Europe plus innovante (14% du budget total) et enfin une volonté d’élargir la participation et de renforcer l’espace européen de la recherche (3,8% du budget total).
La politique de cohésion de l’Union européenne pour la période de programmation 2021-2027 se décline en conséquence : le premier des cinq objectifs spécifiques vise à mettre en place « une Europe plus intelligente par l’encouragement d’une transformation vers une économie intelligente et innovante ».
DOCUMENTS/SITES CLES
Développer la recherche et l’innovation par la coopération transfrontalière - Quelques exemples
En matière de recherche et d’innovation, les stratégies existantes pour l’action publique sont le plus souvent définies dans un cadre national, qui ne s’inscrit pas dans une logique de coopération transfrontalière. Cependant, à une échelle régionale et locale, les territoires frontaliers révèlent des complémentarités possibles entre deux tissus économiques situés de part et d’autre d’une frontière (synergies résidant dans la mise en réseau de ce qui existe de meilleur de chaque côté de la frontière, enrichissement mutuel des cultures scientifiques différentes, complémentarité des spécialités des laboratoires de recherche).
Une fois les potentialités de coopération transfrontalière identifiées, l’enjeu principal pour la recherche et l’innovation consiste à faciliter la mise en réseau des entreprises et des laboratoires de recherche. Cette mise en réseau peut prendre la forme d’un cluster transfrontalier pour un tissu économique très intégré, mais peut également consister en une forme plus classique d’action de facilitation des relations interentreprises ou inter-laboratoires. L’action publique peut donc se concentrer sur les conditions de facilitation de la mise en réseau, notamment en créant l’animation nécessaire et en permettant de dépasser les coûts ou les complications perçues par les acteurs pour travailler en transfrontalier : passer d’une méfiance à une meilleure connaissance réciproque, permettre une lecture plus aisée des différents cadres juridiques, dépasser les barrières administratives et de la langue, identifier et faire connaître les potentialités communes en matière de recherche et d’innovation, apporter une information et une aide sur les possibilités et la procédure de montage de projets Interreg.
Ces complémentarités sont également l’occasion de réaliser des économies d’échelle (mutualisation des coûts de recherche), voire de réaliser un marketing commun, promouvant les innovations et compétences développées ensemble (exemple du cluster franco-suisse Eau Lémanique), tout en ayant une taille suffisamment importante pour être identifié dans la concurrence internationale (exemple du meta-cluster Greater Green dans la Grande Région). La coopération transfrontalière permet alors d’apporter une valeur ajoutée non négligeable aux logiques traditionnelles de recherche et d’innovation des régions frontalières.
Au sein de l’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine-Euskadi-Navarre, par exemple, une stratégie a été mise en place afin de développer l’économie de la connaissance, l’innovation et la compétitivité des entreprises. L’objectif de la stratégie est d’améliorer la connaissance mutuelle et la communication entre les entreprises des 3 régions mais aussi entre tous les acteurs et les facilitateurs de la recherche et développement, l’innovation technologique (développement de start-ups transfrontalières), la formation (apprentissage et universités) et l’emploi. La « Recherche-Innovation Développement économique » est l’un des 3 lignes d’action de l’Eurorégion. On retrouve aussi en ligne d’action l’emploi et l’enseignement supérieur et formation professionnelle.
Autre exemple, l’Offensive Sciences sur le territoire transfrontalier du Rhin supérieur est une initiative commune des Länder de Bade-Wurtemberg et de Rhénanie-Palatinat, de la Région Grand Est et du programme Interreg Rhin supérieur, visant à promouvoir des projets transfrontaliers d’excellence dans le domaine des sciences et de l’innovation.
Quelle articulation avec la politique de cohésion ?
Dans le cadre de la politique de cohésion pour la période 2021-2027, la mise en place d’une « économie intelligente et innovante » passe notamment par la définition d’une stratégie de spécialisation intelligente (S3), dont les projets sélectionnés par la Commission européenne font l’objet d’un financement par le biais du FEDER.
Sept conditions entrent en considération dans la mise en œuvre des S3 :
- Présenter une analyse actualisée des goulets d’étranglement pour la diffusion de l’innovation, y compris la numérisation.
- Disposer d’une institution ou d’un organisme régional/national compétent, responsable de la gestion de la stratégie de spécialisation intelligente.
- Avoir des outils de suivi et d’évaluation permettant de mesurer les performances par rapport aux objectifs de la stratégie.
- Avoir un fonctionnement efficace du processus de découverte entrepreneuriale (EDP)
- Mener les actions nécessaires pour améliorer les systèmes de recherche et d’innovation nationaux ou régionaux
- Avoir des actions visant à gérer la transition industrielle
- Développer des mesures pour la collaboration internationale
La spécialisation intelligente peut être assortie d’une composante transfrontalière, lorsque des potentialités semblables sont identifiées de part et d’autre de la frontière, voire lorsqu’une véritable stratégie de recherche et d’innovation se concrétise dans un domaine précis par des partenariats ou des clusters transfrontaliers. Ces projets de recherche et d’innovation peuvent également être financés au travers des programmes INTERREG, qu’ils intègrent une stratégie de spécialisation intelligente ou non.
Les S3 ont pu être expérimentées par les régions françaises, sur invitation de la Commission et en suivant une méthodologie commune proposée par le niveau national. Elles se sont révélées fructueuses pour les territoires (identification des perspectives de développement, des pistes d’approfondissement et de travail permettant d’accroître l’efficacité des systèmes d’innovation), mais ont rarement souligné des potentialités transfrontalières.
Au-delà des projets de clusters transfrontaliers bien identifiés, la recherche et l’innovation peuvent aussi recouvrir des dimensions plus classiques d’encouragement à la recherche et concerner l’ensemble des formes de l’innovation (produit, processus, procédé, organisation, innovation sociale). La spécialisation intelligente est par essence liée à la dimension territoriale de l’innovation. Ainsi, les domaines stratégiques pouvant donner lieu à des actions innovantes recouvrent aussi bien les technologies de pointe des clusters précités, que des projets concernant l’agriculture, la filière bois, l’artisanat ou encore les services de proximité. La politique de cohésion s’attache dans tous les cas à mettre en valeur les projets qui permettent de créer des liens entre pouvoirs publics, chercheurs, entreprises et citoyens.
Dans ce cadre, le concept de « living labs » ou laboratoire vivant constitue une forme novatrice d’innovation : testée dans le cadre du programme franco-italien ALCOTRA, cette méthode place les utilisateurs au cœur du processus de conception et de décision, en testant et optimisant les solutions sur le terrain et non plus dans un laboratoire, d’où son nom. Elle permet ainsi la mise en réseau de l’ensemble des acteurs socio-économiques concernés par l’innovation, dans un contexte transfrontalier : actions pilotes menées dans le cadre de marchés publics transfrontaliers (Vallée d’Aoste) ou de la mobilité intelligente (Piémont et Ligurie).
Recommandations
A l’échelle locale
- Identifier les potentialités transfrontalières pour la spécialisation intelligente en concertation avec les territoires voisins concernés :
– Analyse des tissus économiques de part et d’autre de la frontière et de leurs complémentarités existantes et potentielles en matière de R&D.
– Analyse des complémentarités transfrontalières existantes et potentielles en matière d’offre de R&D (laboratoires de recherche publics et privés, universités).
– Proposition de spécialisation(s) économique(s) commune(s) en concertation avec les acteurs socio-économiques de part et d’autre de la frontière et analyse de la valeur ajoutée d’une spécialisation économique transfrontalière dans l’économie globalisée (mise en valeur des avantages compétitifs). La spécialisation économique d’un territoire inclut la nécessité de faire des choix sur le(s) secteur(s) économique(s) soutenus.
- Inscrire les objectifs d’innovation et de spécialisation économique dans un projet de territoire partagé :
– Importance du portage politique du volet transfrontalier d’un projet de spécialisation intelligente.
– Partage des objectifs avec une cohérence des S3 concernées par le territoire transfrontalier.
- Créer les dispositifs permettant la mise en réseau des entreprises, des laboratoires de recherche et des universités ; faciliter les transferts technologiques :
– L’outil cluster est identifié comme le plus important, dans la vision européenne de spécialisation économique alliée à la recherche et à l’innovation ; il permet la mise en réseau de l’ensemble des acteurs cités plus haut.
– Des outils de mise en réseau autres qu’un cluster peuvent permettre de porter spécifiquement l’innovation en transfrontalier et les transferts technologiques.
– Organisation des infrastructures de recherche en réseau en s’assurant d’une unité d’animation scientifique et d’administration
– Favoriser des expérimentations transfrontalières sur la formation et la mobilité fonctionnelle et géographique, impulser des partenariats en formation tout au long de la vie et en formation doctorale.
– Outre la dimension d’animation du réseau, l’action publique peut contribuer à donner un appui technique pour la constitution de projets Interreg. Elle se concentre sur l’excellence et la cohérence des projets de recherche et d’innovation avec les objectifs de spécialisation intelligente du territoire transfrontalier.
Aux échelles régionales et nationales
- Appuyer la recherche de spécialisations économiques transfrontalières :
– par l’appui méthodologique à la constitution d’une S3, ce qui implique une recherche des potentialités transfrontalières ;
– par la valorisation de la logique de cluster atteignant une masse critique pour la concurrence internationale ;
– par la coordination avec les autorités nationales/régionales voisines.
- Accompagner la recherche et l’innovation en transfrontalier par les programmes Interreg :
– par la promotion accrue des spécialisations intelligentes définies par les territoires, incluant de faire des choix dans les projets soutenus, qui devront désormais se concentrer sur les priorités stratégiques régionales préalablement définies ;
– en favorisant l’excellence des projets de recherche et d’innovation, concentrant à la fois une thématique précise rentrant dans le cadre de la spécialisation économique et une multiplicité d’acteurs socio-économiques de part et d’autre de la frontières : pas uniquement des entreprises ou des universités entre elles, mais le mélange d’acteurs multiples ;
– en recherchant l’articulation avec les autres programmes de la politique de cohésion et les programmes européens sur la recherche et l’innovation : programme « Horizon Europe ».
A l’échelle européenne
- Accompagner la dimension transfrontalière de la recherche et de l’innovation par :
– la mise en réseau des expériences menées et le partage des bonnes pratiques ;
– la communication autour des priorités européennes 2021-2027 (spécialisation intelligente des territoires) et leurs déclinaisons transfrontalières en matière de recherche et d’innovation (attribution des fonds européens et articulation de ces fonds entre eux via de nouvelles synergies) ;
– la communication auprès des acteurs publics et privés sur la valeur ajoutée de la dimension transfrontalière dans la spécialisation intelligente (apports mutuels grâce aux pratiques et connaissances différentes, économies d’échelles, identification globale d’un territoire, taille critique pour la concurrence internationale).
– un référentiel d’évaluation et de monitoring de l’action publique en matière de coopération transfrontalière.