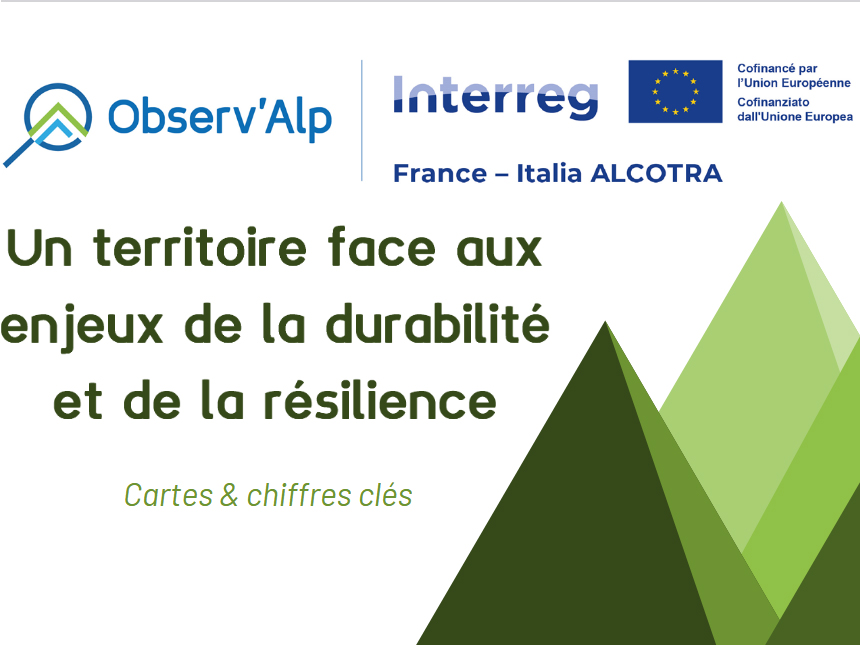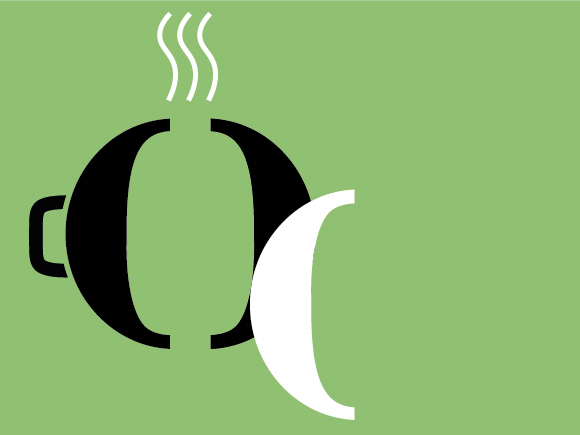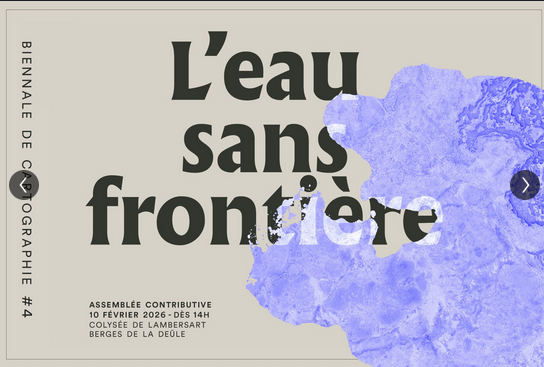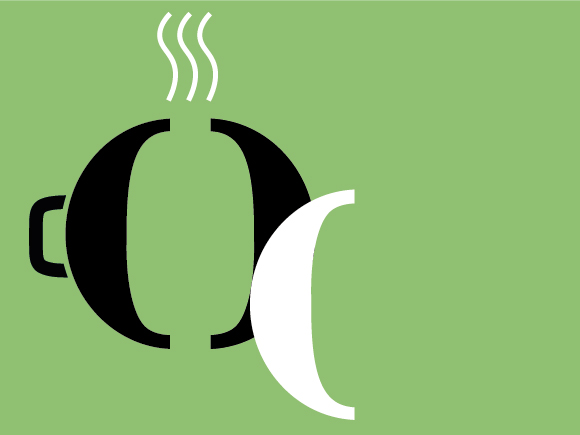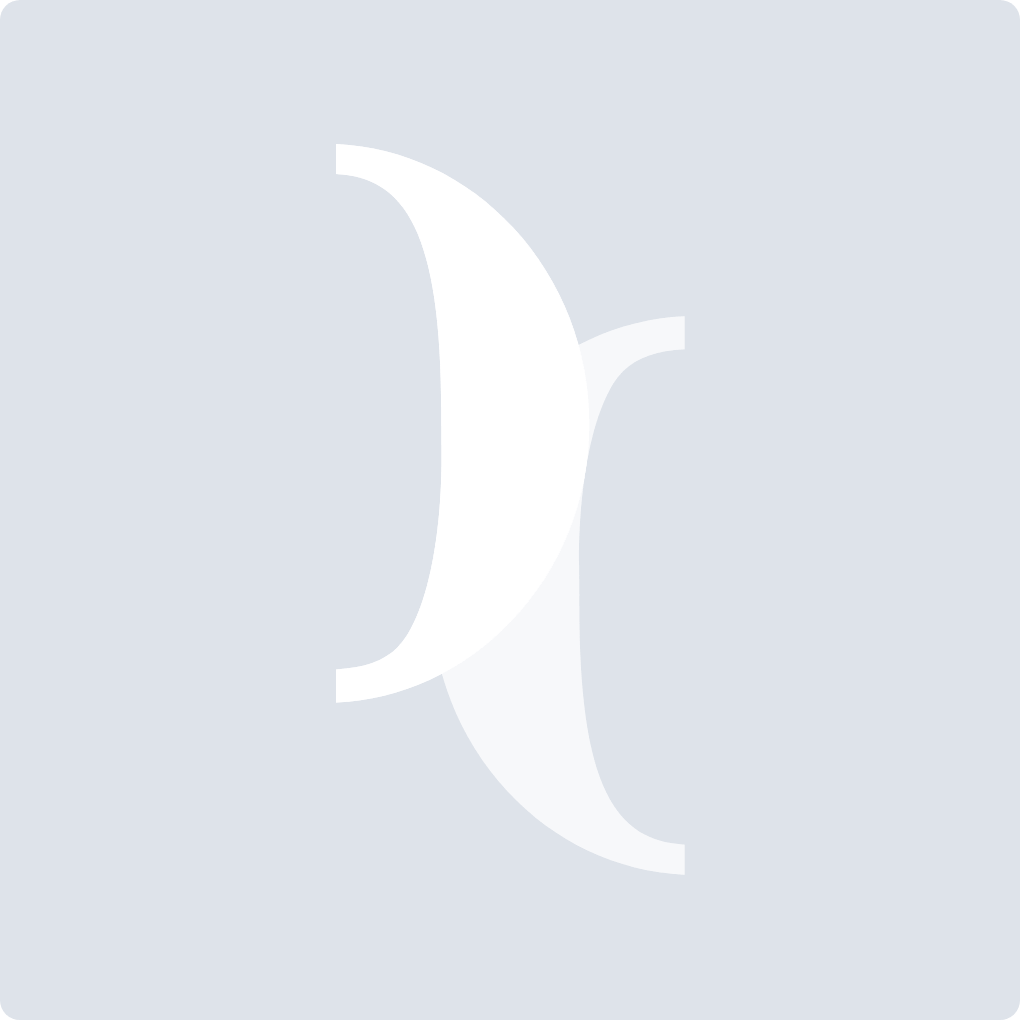Fleuves et rivières
- Actualités
- Événements
- Publications MOT
Introduction
L’eau ne connaît pas de frontières. Les rivières transfrontalières ont constitué pendant longtemps les principales voies de communication d’un pays à l’autre et quand elles matérialisaient la frontière, elles ont permis l’émergence de véritables creusets de culture commune, à l’exemple du Rhin supérieur.
Les cours d’eau en France comme dans le reste de l’Europe et du monde peuvent également traverser les frontières et nécessitent une solide coopération transfrontalière pour s’emparer équitablement des questions de gestion des eaux d’amont en aval.
La notion de bassin versant est essentielle à prendre en compte dans le cadre d’une coopération transfrontalière, au-delà des cas de fleuves-frontières et rivières-frontières. En effet, la gestion d’amont en aval rappelle aux différents acteurs l’importance de la communication et du contrôle des usages du cours d’eau.
Les fleuves et rivières sont également synonymes d’identité territoriale pour les habitants de la région concernée. Cette identité fluviale se retrouve notamment le long du fleuve Danube qui a bénéficié au cours du temps d’une grande tradition littéraire et musicale dans sa célébration, mais aussi autour de cours d’eau moins grands, que les acteurs locaux et institutionnels veillent à valoriser au travers de projets contemporains et dans le cadre de programmes de financements européens.
Enjeux des bassins fluviaux transfrontaliers
Il existe dans le monde 260 bassins fluviaux transfrontaliers partagés entre au moins deux pays. 15% des pays dans le monde dépendent à plus de 50% des ressources en eau d’un autre pays frontalier.
Les fleuves et rivières font aujourd’hui l’objet d’une grande préoccupation écologique du fait de la fragilité de leurs écosystèmes. En effet, ils sont particulièrement sujets à l’absorption des rejets des sites miniers, pétroliers et plus largement industriels ce qui illustre la pertinence de la gestion transfrontalière des eaux d’amont en aval, lorsqu’au moins deux Etats sont riverains et se partagent le cours d’eau en question.
Ils représentent de forts enjeux économiques à valoriser de diverses façons, notamment en raison d’un potentiel :
- touristique,
- de transport,
- d’emploi énergétique et industriel,
- lié au patrimoine culturel.
Les conflits transfrontaliers liés à la ressource en eau sont nombreux. La pollution des fleuves et rivières a des conséquences systématiques sur les territoires de part et d’autres des frontières. Si, depuis plusieurs siècles, de nombreux accords ont été signés entre pays riverains pour assurer la liberté de navigation sur les fleuves transfrontaliers, ainsi que, depuis la fin du XIXème siècle, pour la construction de barrages hydroélectriques, aujourd’hui encore, il n’existe que trop peu d’accords, de conventions ou de traités concernant la lutte contre les pollutions, la gestion des aquifères et a fortiori la gestion intégrée des bassins partagés. En Europe, la gestion transfrontalière de ces cours d’eau est une thématique de coopération en plein développement et constitue un axe original de l’intégration européenne, qui dépasse l’enjeu fondamental de l’environnement pour revêtir également une dimension symbolique et culturelle forte.
La Directive Cadre sur l’Eau de la Commission européenne, publiée en 2000, a concrétisé une série d’orientations claires en matière de coopération transfrontalière sur les cours d’eau. Cadre de la politique européenne en la matière, son objectif était d’atteindre pour 2015 un bon état des ressources en eau de surface et souterraine. Selon la Commission européenne, l’objectif de la Directive-Cadre n’aurait cependant été atteint que pour la moitié des ressources européennes en eau.
Afin de réaliser cet objectif, les Etats frontaliers mettent en place des outils pour gérer conjointement les cours d’eaux, à l’image des Contrats de rivières transfrontaliers (CRT). Ceux-ci constituent des accords techniques et financiers, qui recouvrent l’ensemble des cours d’eaux d’un bassin et permettent la mise en œuvre d’études thématiques transfrontalières dans des domaines variés (assainissement, lutte contre les crues, gestion de la ressource, aménagement des berges). Sur la quasi-totalité des frontières françaises, des CRT ont été signés.
Plus d’infos sur le site web GEST’EAU et sa carte de situation des contrats de milieu.
Programmes européens
Quelques programmes européens permettent de financer des projets relatifs au management des bassins fluviaux. Au-delà des programmes de la Politique de cohésion qui permettent de financer des projets à travers les fonds structurels européens comme le FEDER (programmes Interreg) et le FEADER, d’autres programmes agissent dans le domaine de l’eau et peuvent se décliner en projets transfrontaliers, comme :
- Le programme LIFE soutient les politiques en faveur de l’environnement et notamment à travers son sous-programme « Environnement » qui intègre, dans le domaine prioritaire « Environnement et utilisation rationnelle des ressources », des projets de résolution de problèmes de pressions hydromorphologiques, de pollution et de renaturalisation de la morphologie des rivières, ainsi que toutes actions visant à garantir une utilisation sûre et efficiente des ressources en eau, améliorant la gestion quantitative de l’eau, préservant un niveau élevé de qualité de l’eau et évitant les utilisations abusives et la détérioration des ressources en eau.
Quelques exemples
Le bassin franco-genevois
La Convention de 1962 concernant la protection des eaux du lac Léman contre la pollution est pionnière dans le domaine de la coopération transfrontalière fluviale. On compte pas moins de cinq Contrats de rivières transfrontaliers sur le bassin franco-genevois, émaillé de nombreux cours d’eaux. Chaque contrat est passé entre le Canton de Genève d’une part et les partenaires concernés côté français (Etat, Région, département, agences de l’eau, etc.). Cette coopération s’est concrétisée par exemple par la signature d’un accord transfrontalier pour la gestion de l’eau et du milieu aquatique entre les acteurs de l’agglomération transfrontalière du Grand Genève. Plus d’infos sur le contrat de rivières transfrontalier entre Arve et Rhône.
Un protocole d’accord transfrontalier pour la gestion sédimentaire du Haut Rhône
La préfecture de l’Ain et le Canton de Genève ont conclu en septembre 2015 un protocole d’accord fixant les modalités de gestion transfrontalière des sédiments du Haut Rhône. Ce texte concrétise les travaux d’un comité technique franco-suisse institué en 2012 et qui fixe les modalités de gestion pour la décennie à venir. Destinée prioritairement à garantir la sécurité des riverains face aux crues, la gestion sédimentaire du Haut Rhône prend en compte les intérêts socio-économiques des acteurs concernés le long du fleuve tout en préservant l’environnement. « C’est grâce à une gestion concertée et coordonnée des sédiments entre la Suisse et la France que les autorités parviennent à garantir la sécurité des riverains du Rhône lors de fortes crues, comme celle qu’a connue l’Arve au début du mois de mai 2015. » (La Voix de l’Ain, 11 septembre 2015).
Le Rhin supérieur
Autre exemple emblématique et précoce de coopération transfrontalière dans ce domaine : la gestion du Rhin sur la frontière franco-allemande. Long de 1320 km et représentant un bassin versant de 185 000 km², le fleuve rhénan fait partie d’un vaste « District hydrographique International » et fait l’objet d’une Commission internationale de protection du fleuve, qui réunit depuis 1950 les ministres de l’environnement des pays riverains. Une première convention, signée en 1963, a concrétisé la lutte contre la pollution, problème majeur et chronique de cette voie fluviale la plus utilisée d’Europe. La Convention pour la protection du Rhin a ensuite été signée en 1999.
Faisant suite au « Programme d’action du Rhin » réalisé entre 1987 et 2000, un programme d’ensemble « Rhin 2020 » pour le développement durable du fleuve a été adopté par la Commission Internationale pour la Protection du Rhin. Ce programme combine les intérêts écologiques et ceux de la prévention des crues, la protection des eaux de surface et celle des eaux souterraines dans l’espace rhénan jusqu’à 2020.
Outre ce programme, de multiples projets ont été réalisés sur le cours du fleuve, notamment pour la protection de la nappe phréatique. Par exemple, le projet LOGAR (Liaison opérationnelle pour la gestion de l’aquifère rhénan) vise à améliorer l’état de la nappe rhénane (un tiers de l’eau contenue dans celle-ci s’étant dégradée selon une étude parue en 2009) et à mettre en place un outil de gestion transfrontalier.
La démarche binationale du Doubs franco-suisse
Le Doubs constitue une frontière sur 45 km entre la France et la Suisse. Ce bassin versant se caractérise par un fort potentiel biologique, une faible densité urbaine ainsi qu’une occupation humaine limitée.
Afin de mieux appréhender ses problématiques (impact de trois barrages hydroélectriques, sensibilité aux altérations de la qualité des eaux, surmortalité piscicole en 2010-11, nombreuses ruptures de la continuité écologique), de nouvelles instances de gouvernance ont été créées en 2011 répondant à la nécessité d’une démarche globale et concertée :
- une Commission mixte gérant l’harmonisation des dispositions relatives à la pêche et la protection du poisson ;
- un Groupe de travail « Gestion des débits » (2011) pour améliorer la gestion des ouvrages hydroélectriques et de leurs impacts écologiques (co-présidé par la DREAL et l’OFEN) ;
- un Groupe de travail « Qualité des eaux et des milieux aquatiques » (2011) qui intervient su la qualité de l’eau, la protection des espèces, la morphologie et s’appuie pour cela sur un secrétariat technique assuré par l’EPTB Saône et Doubs. Il se réunit en moyenne deux fois par an (co-présidé par la DDT du Doubs et l’OFEV).
Ce dernier a présenté début 2014 un plan d’action comportant plusieurs mesures pour assainir le Doubs et réduire l’impact des activités humaines sur le bassin :
- Améliorer la qualité physico-chimique des eaux impliquant la réduction de flux des flux de pollution quelles que soit leur origine et une action sur les assainissements collectif et individuel
- Restaurer la continuité écologique (entre autres piscicoles) et la morphologie du Doubs et de ses affluents
- Suivre de façon partagée et transfrontalière l’évolution de l’état du Doubs en trouvant les méthodes d’exploitation des données appropriées
Ainsi, ce plan d’action se transcrit en actions concrètes comme la modernisation de stations d’épuration en France et en Suisse, la suppression de quatre des treize seuils ou barrages qui entravent la circulation des poissons, un programme d’amélioration de la connectivité des affluents du Doubs ainsi que deux études (synthèse des données sur la qualité des eaux du Doubs, solutions techniques aux enjeux de migration piscicole).
Quelques autres exemples sur les frontières françaises
La coopération transfrontalière dans ce domaine permet également de répondre aux enjeux de valorisation du patrimoine naturel du territoire. En témoigne le projet « Bande Bleue », soutenu par l’Eurodistrict SaarMoselle, qui a pour objectif de mettre en valeur l’axe de la Sarre, à travers le réaménagement des berges du fleuve, mais aussi avec les projets portés par le SMEAG (Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement de la Garonne), sur la frontière franco-espagnole.
L' »Espace bleu » de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai : une initiative transfrontalière et participative centrée sur l’eau sous toutes ses formes, visant à favoriser le dialogue et la collaboration entre acteurs politiques et techniques, associations et citoyens pour valoriser, proposer et réaliser des actions innovantes. Le projet propose la création d’un atlas collaboratif identifiant les acteurs et projets autour de l’eau, des actions locales dans les 147 communes eurométropolitaines et une grande fête de l’eau. L’Eurométropole a par la suite lancé le projet « Blue walks » pour valoriser ce Parc Bleu : 13 balades programmées entre avril et septembre 2019 de part et d’autre du domaine fluvial transfrontalier, présentées dans les deux langues (le français et le néerlandais).