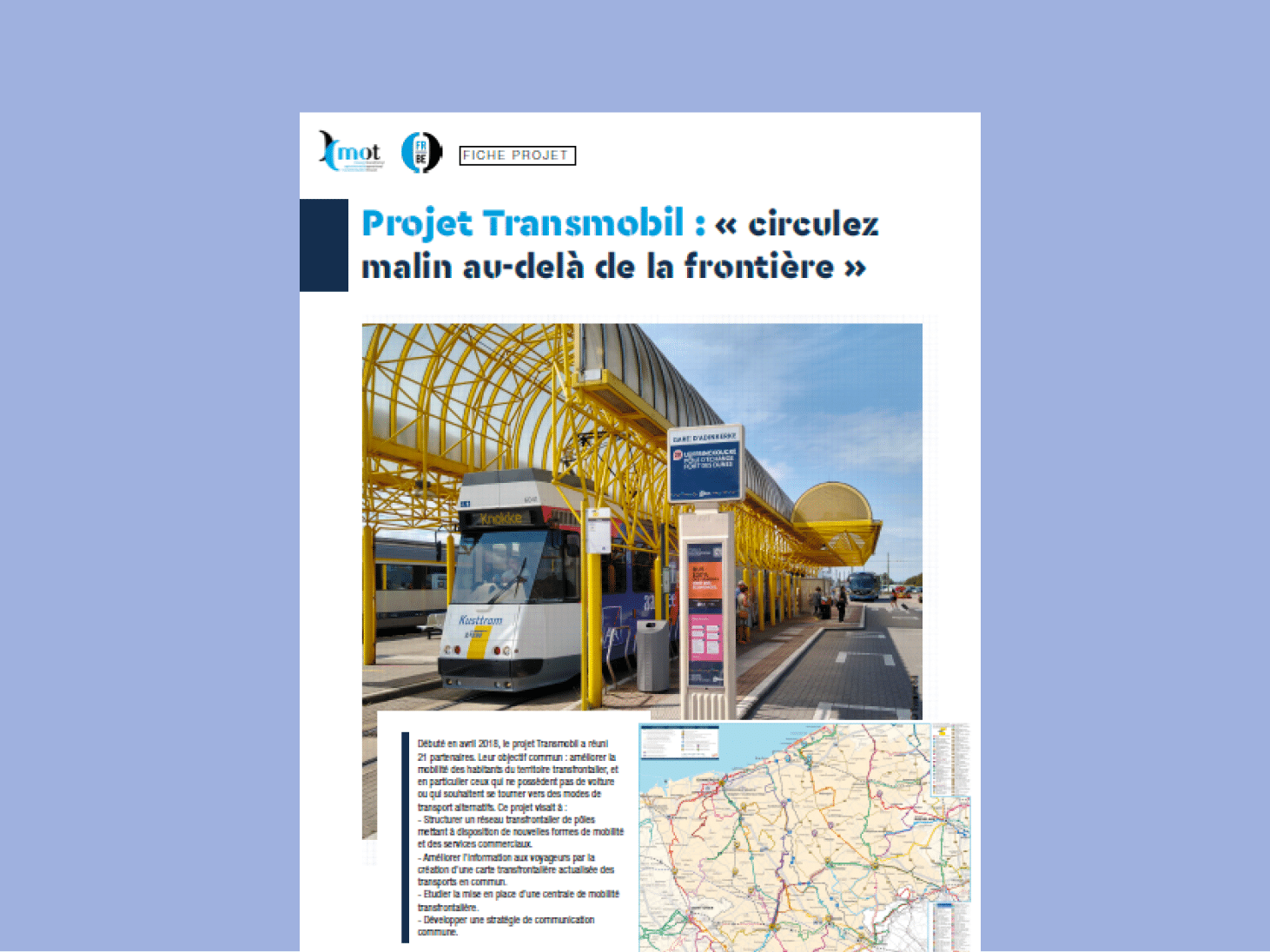Les territoires transfrontaliers à l’heure de la loi « Décentralisation, Différenciation & Déconcentration »
Si chaque territoire se singularise par des composantes géographiques, socio-économiques, et culturelles qui lui sont propres, les environnements institutionnels et juridiques dans lesquels évoluent les espaces transfrontaliers ne ressemblent à aucun autre.
Au croisement de deux périmètres nationaux de régulation, ces territoires sont administrés par des collectivités et des institutions aux compétences, aux modalités d’organisation et aux capacités d’action différentes de part et d’autre de la frontière, rendant l’exercice de coordination d’autant plus complexe.
Peut-être plus qu’ailleurs, la faculté d’adaptation des autorités aux spécificités locales prime pour permettre le véritable développement à 360° de ces espaces. La crise sanitaire a d’ailleurs mis à nu ces problématiques, en donnant à voir le "double confinement" engendré par les fermetures unilatérales de frontières (services de proximité
inaccessibles, familles séparées, champs de mobilité entravés, emplois menacés et stigmatisation des travailleurs transfrontaliers…).
Les perspectives d’évolution amenées par le futur projet de loi "Décentralisation, différenciation et déconcentration" (3D) arrivent à point nommé pour assurer de plus fortes marges de manœuvre à ces territoires.
Les dévolutions de pouvoir règlementaire aux acteurs locaux (services déconcentrés de l’Etat & collectivités locales), la généralisation des contrats globaux de territoires, la modularité des compétences des collectivités selon leurs enjeux, en suivant l’exemple de la future Collectivité Européenne d’Alsace (CEA), font partie des avancées vers une approche du développement territorial pleinement centrée sur les espaces fonctionnels. Le succès de ces orientations ne dépendra ensuite que de la capacité à s’inscrire dans l’exercice de la gouvernance multi- niveaux et dans des démarches volontaristes de coopérations aux frontières.
Plus d’infos