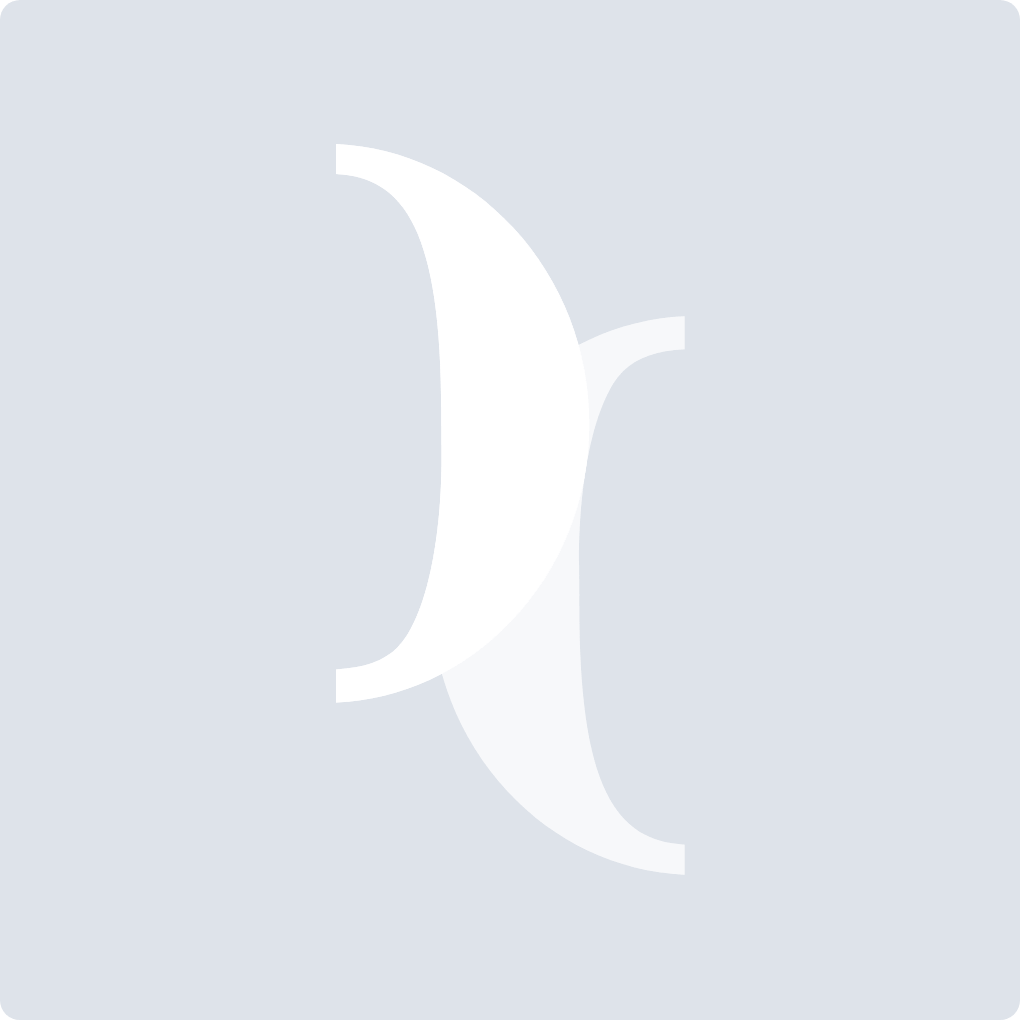Cadre juridique et financements
Le cadre juridique
Les collectivités concernées peuvent s’appuyer sur un cadre juridique commun. Depuis le mois de juillet 2004, l’Accord de Karlsruhe (1996), accord quadripartite entre la France, le Luxembourg, l’Allemagne et la Suisse, a été étendu à l’ensemble de la frontière franco-suisse. Cet accord a pour objet de faciliter et promouvoir la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux français, allemands, luxembourgeois et suisses dans leurs domaines de compétences communs. Il permet aux collectivités d’intervenir selon deux modalités. Elles ont d’une part la possibilité de signer des conventions de coopération qui permettent aux parties de coordonner leurs décisions, de réaliser et gérer ensemble des équipements ou services publics d’intérêt local ; d’autre part la possibilité de créer des organismes transfrontaliers tels que le Groupement local de coopération transfrontalière (GLCT) au sein duquel les collectivités territoriales situées de part et d’autre des frontières peuvent se regrouper ; cette structure est alors soumise au droit interne applicable aux établissements publics de coopération intercommunale de la partie où elle a son siège.
Un Groupement européen de coopération territoriale (GECT), structure de l’Union européenne révisée par le règlement CE n°2013/1302, peut désormais être créé entre des partenaires franco-suisses, dès lors qu’il conserve son siège au sein de l’Union européenne (côté français).
Les travaux du Conseil de l’Europe sur la création d’une nouvelle structure, le Groupement eurorégional de coopération (GEC), possible à l’échelle des Etats du Conseil de l’Europe, ont abouti à la signature en novembre 2009 du troisième protocole à la Convention-cadre de Madrid instituant cette nouvelle structure de coopération.
Il est entré en vigueur en Suisse au 1er mars 2013 et en France au 1er mai 2013. Le GEC constitue une structure analogue au GECT.
Malgré la présence d’une frontière externe à l’Union européenne, le décalage entre les systèmes d’organisation institutionnelle (rôle des Cantons), les différences fiscales et monétaires, les démarches transfrontalières entreprises à Bâle avec la constitution d’un Eurodistrict ou à Genève avec la création d’un Groupement local de coopération transfrontalière (GLCT) témoignent de la volonté de coopération sur cette frontière.
Plus d’infos sur le cadre légal à la frontière franco-suisse (dans les ressources juridiques de l’Espace membres – à venir).
Modalités de cofinancement de la Confédération suisse et Nouvelle politique régionale suisse (NPR)
Les programmes Interreg s’inscrivent dans le cadre de la Nouvelle politique régionale suisse (NPR). Ainsi, la Confédération peut soutenir des projets Interreg à condition qu’ils poursuivent les objectifs principaux de la NPR.
De leur côté, les cantons ont la possibilité de financer de manière autonome les projets transfrontaliers qui seraient hors du champ de la politique régionale suisse mais dont le type d’action est prévu par le programme opérationnel France-Suisse.
La place des territoires transfrontaliers dans la nouvelle stratégie d’aménagement suisse : le Conseil fédéral suisse a adopté sa nouvelle stratégie d’aménagement le 26 juin 2024. Elle vise à renforcer les différents espaces fonctionnels du territoire (agglomérations, espaces ruraux et montagnards) et s’étend jusqu’en 2031. Les territoires frontaliers à la Suisse y sont pleinement intégrés et considérés comme des espaces fonctionnels et étroitement imbriqués nécessitant une attention particulière. Ainsi, la politique régionale encourage « les mutations structurelles dans les régions de montagne, les espaces ruraux et les régions frontalières en renforçant leur compétitivité, notamment celle de leurs centres ». Elle affirme notamment le rôle des programmes et réseaux de coopération territoriale européenne (Interreg, ESPON, Convention Alpine…) dans le soutien des projets au niveau transfrontalier et international.
Plus d’infos dans notre article :